
-
Centre d'Études et de Recherches
-
sur les Phénomènes Inexpliqués
|
|
|
Il l'est assurément de nos jours, mais les choses étaient bien différentes en
1908, alors que l'on ne parlait pas encore de bombe atomique. L'histoire nous renseigne que la première bombe atomique a été
lancée sur Hiroshima en 1945, puis sur Nagasaki, la même année. C'est ce qui mit un terme à la seconde guerre mondiale de manière
définitive, alors que les Allemands avaient déjà capitulé mais que les Japonais restaient sur le pied de guerre. Tout le courage
japonais avait été réduit à néant face à l'apocalypse de la nouvelle arme des États-unis. Mais les annales de la guerre nous
rappellent aussi qu'il y eut un fameux coup de bluff des américains. En fait, ceux-ci venaient à peine de terminer la mise au point de la
bombe et ne disposaient que de ces deux exemplaires. Faire croire au Japon que l'Oncle Sam pouvait rééditer l'exploit à volonté
ne correspondait à aucune réalité. Bien sûr, les dégâts étaient amplement suffisants, mais où en était-on réellement en 1945
aux États-unis sur le plan nucléaire ? Est-il seulement permis d'imaginer que la Russie aurait disposé de la même arme près d'un
demi-siècle avant son éternel rival ?
Ne nous aventurons pas sur ce terrain pour l'instant et revenons-en à notre hypothèse de phénomène naturel.
Pourquoi exclure d'emblée cette possibilité après tout assez évidente. En effet, pourquoi un météorite, de taille pour le moins conséquente et inhabituelle
certes, n'aurait-il pas pu percuter notre planète et produire une telle pagaille ?
La réponse à cette question nous paraît claire et indiscutable et relève de la science. Faisons donc une large parenthèse pour
expliquer nos propos. (Si l'affaire de la Tungunska relevait d'un phénomène naturel, elle ne disparaîtrait pas pour autant de notre
champ d'investigations, elle deviendrait alors un phénomène beaucoup moins auréolé de mystère mais néanmoins largement digne d'intérêt
comme on peut facilement le comprendre vu l'étendue du désastre).
Contrairement à ce que l'on pourrait peut-être penser, la chute de météorites sur notre planète n'est pas rare.
La masse totale de matière interplanétaire balayée par la Terre est estimée à 1012 kg/jour; cette matière est constituée essentiellement de poussières, avec un nombre de corpuscules dépendant (approximativement) du
logarithme de l'inverse de leur masse, avec un seuil d'environ 10-16 kg, en dessous duquel il y a très peu de poussières.
Ainsi, la Terre ne rencontre guère plus de 2000 à 3000 météorites de plus d'un kilogramme par jour. (ce n'est tout de même pas mal, principalement pour qui se trouverait juste en dessous ! Mais, nous allons le voir, cette possibilité n'a pratiquement aucune chance de se produire)
Lorsqu'elles pénètrent dans l'atmosphère, le frottement sur les particules la constituant entraîne un violent échauffement et une émission de lumière, ce qui forme un météore ou étoile filante: les poussières d'environ 10-14 kg et moins sont volatilisées, mais pas détruites: les produits minéraux formés se condenseront et tomberont très lentement sur la surface terrestre; les poussières de taille supérieure constituent les micrométéorites,
une partie de leur matière ne sera pas volatilisée et tombera au sol comme des grains de sable; en dessous d'une certaine taille (fonction inverse de la cohésion de leur matière constitutive) la plupart des météorites se désagrègent en blocs tout au long de leur traversée dans l'atmosphère, ce qui réduit le nombre des gros impacts sur la surface de la Terre : environ 500 pierres de la taille d'une balle de tennis atteignent ainsi le sol chaque année. On le voit donc, la plupart des projectiles supposés pouvoir arriver jusqu'à nous subissent un traitement tel que les risques sont infimes (à défaut d'être nuls). Voilà donc ce qui se passe au quotidien sur notre planète et, on en conviendra facilement, cela n'a absolument aucun rapport avec ce qui nous intéresse. On est loin du compte. Mais peut-on imaginer des météorites de plus grosse taille ?
Des météorites plus massives, heureusement rares (l'histoire humaine écrite n'en relate que deux) peuvent créer d'importants cratères lors de leur impact sur le sol, ou des tsunamis en cas d'arrivée en mer.
L'énergie libérée lors de ces impacts peut entraîner, directement ou par des effets secondaires catastrophiques (par ex. réactivation de volcans endormis, incendies généralisés etc.), la dispersion d'une quantité considérable de particules dans l'atmosphère, suffisante pour modifier brutalement et durablement le climat sur l'ensemble de la Terre. Suivant une théorie catastrophiste, l'extinction des dinosaures, qui marque la fin du Crétacé, s'expliquerait par les conséquences de l'impact d'une météorite.
Or donc, si l'on se base sur ce que l'on sait des météorites, oui c'est possible. Non seulement c'est possible mais, en plus, c'est déjà arrivé... deux fois dans l'histoire de l'humanité. avouons que comme fréquence on a vu pis !
Dès lors, la probabilité pour que ce genre de phénomène se produise deux fois, à seulement quelques années d'intervalle est "pratiquement" réduite à néant. Mais "pratiquement" seulement aussi. Un chiffre proche de zéro n'est pas égal à zéro. Cette même probabilité semble découler de la plus haute fantaisie lorsque l'on imagine que ce cas rarissime se produise non seulement deux fois en peu de temps, mais en plus approximativement au même endroit. Il y a toutefois ici un point qu'il nous faudra relativiser dans notre appréciation comme nous le verrons plus loin, mais ce n'est pas cela qui mettra notre hypothèse à mal.
La trajectoire d'une météorite peut-elle être oblique comme cela semble être le cas dans l'illustration ci-contre ? Oui, assurément aussi. Nous oserions même affirmer qu'il pourrait difficilement en aller autrement vu la rotation de la terre, les forces de frottement et la probabilité nettement en faveur d'une course s'éloignant de la rectiligne lors de l'entrée dans l'atmosphère.
Mais alors pourquoi pas ?
Nous l'avons vu, jusqu'ici les choses demeurent toujours théoriquement possibles.
La probabilité extrêmement réduite ne permet toutefois pas de la rejeter complètement et il nous faut donc poursuivre l'analyse du cas.
Or, nous l'avons vu dans le témoignage tungu, l'impact dont il est question ici provient d'un
objet cylindrique tombant à la verticale ! Nous pouvons ici affirmer que cela met un terme définitif à toute possibilité de
météorite. Aucune météorite ne peut (et n'a jamais été) cylindrique, il s'agit d'une profonde aberration et même d'une impossibilité car, en admettant même que la météorite ait été initialement cylindrique, elle ne pouvait plus l'être au moment de son impact. De plus, la trajectoire décrite est "verticale". Or donc, si la théorie d'une catastrophe naturelle n'est toujours pas écartée, en
revanche on peut affirmer qu'il ne s'agit à coup sûr pas d'une météorite.
Mais de quels phénomènes naturels disposons-nous pour expliquer la chute d'un objet cylindrique, à la verticale et avec autant d'effets dévastateurs, deux fois au même endroit ?
On le voit, cette théorie ne peut pas être soutenue. Du moins pas si l'on s'en tient aux observations dont nous faisons état.
Et c'est là que commence la controverse...
En Russie, à 60 km de la petite ville de Vanavara, dans la matinée du 30 juin 1908 à 7h17mn11s (heure locale), un météorite (comète) dont les caractéristique furent d'abord estimées aux alentours de 500 mètres de diamètre et 10 millions de tonnes avant qu'une nouvelle simulation présentée en 2007 par les laboratoires Sandia ne réduisent l'estimation à 62000 tonnes a explosé en altitude à environ 5 km du sol au-dessus de la Toungouska.
L'explosion détruisit intégralement la forêt dans un rayon de plus de 20 km; le souffle fit des dégâts sur plus de 100 km et la déflagration fut audible dans un rayon de 1500 km. De nombreux incendies se déclenchèrent, brûlant des zones forestières pendant plusieurs semaines. Un vortex de poussière et de cendres se forma et fut entraîné jusqu'en Espagne par la circulation atmosphérique, créant des halos dans la haute atmosphère, qui s'étendirent sur tout le continent. Une luminosité
exceptionnelle en pleine nuit fut constatée pendant plusieurs jours en Europe occidentale, à tel point qu'on pouvait lire un journal de nuit. Cette explosion libéra une énergie de 15 mégatonnes, soit mille fois la bombe d'Hiroshima. Si elle était tombée trois heures plus tard, la rotation de la Terre aurait amené Moscou juste en dessous du point d'impact.
Jusque là, tout cela ne nous apprend pas grand chose sinon que les chiffres relatifs à un même événement ont tendance à se modifier avec le temps ! On s'en souvient, on avait d'abord parlé d'une météorite faisant probablement plusieurs dizaines de mètres de diamètre. On nous apprend maintenant qu'elle aurait pu faire quelque 500 mètres. Encore une fois, vu l'ampleur des dégâts, on ne sera guère étonné de ces proportions titanesques et tout à fait inhabituelles, mais de là à aboutir à une erreur
d'estimation aussi flagrante, il y a une marge que nous hésitons à franchir. D'autre part, on part d'une estimation pondérale de 10 millions de tonnes à une seconde version ne faisant plus "que" 62.000 tonnes ! Voilà donc une information intéressante qui semble mettre un point final à l'affaire en démontrant qu'il s'agissait bien d'un phénomène naturel. Un phénomène rarissime, certes, mais naturel tout de même. Seulement voilà, c'est à nous de ne plus être d'accord avec cette version des choses car enfin, de qui se moque t'on? Il reste la dernière partie de ce qui a été avancé en 2007, soit l'explosion en altitude (voilà qui explique
parfaitement l'absence de cratère et de point d'impact) d'un "petit" (Ah bon !) noyau cométaire. Jusque là, il y a moyen d'admettre.
On nous explique aussi que ce noyau était constitué essentiellement de gaz gelés qui auraient fondu (Une fois encore, nous ne nous
permettrons pas de critiquer l'intelligence des chercheurs, mais nous tiquons quant à la possibilité d'établir cette hypothèse
cinquante ans après les faits. Les gaz sont par définition très volatiles. Lors de leur entrée dans l'atmosphère, ils ont été soumis à de fortes températures qui auront donc provoqué leur dégel : très plausible. Ils fondent donc, la logique se poursuit. Ils explosent enfin, en altitude, d'accord. Et on en retrouve la trace cinquante ans plus tard ? La suite nous parle des sphérules que nous avons déjà évoquées.
Cette hypothèse nous paraît donc très difficilement soutenable, proche de la plus haute fantaisie. Il ne s'agit d'ailleurs que d'une hypothèse et non d'une explication. Le mystère reste donc entier et même encore plus épais, car ces sphérules existent bel et bien. C'est un fait : il y en avait. Mais cela n'explique toujours rien non plus à propos de la forme cylindrique de ce bolide, ni de sa trajectoire verticale. Il y a des contradictions et tout cela ne se tient pas. Et puis, parle t'on de la première affaire ou de sa réplique ? Mêmes causes et mêmes effets ? Vraiment très difficile à croire.
Mais nous allons rapidement nous rendre compte que les choses peuvent facilement être envisagées selon une autre
optique. En effet, l'événement ayant eu lieu en 1908 et la première expédition en 1927, il est clair et c'est un fait avéré (tout autant que logique et légitime) que les Russes furent les premiers sur place. D'autre part, entre 1927 et 1958, ils ont aussi eu tout le loisir d'y revenir à leur guise. La question subsidiaire pourrait donc se résumer comme suit : que s'est-il passé dans ces intervalles exploités par les Russes ? C'est notamment là que ce qu'avait avancé notre administrateur principal en introduction au présent dossier prend toute sa signification.
On ne peut pas traiter une affaire telle que celle de la Toungouska comme on aborde une "simple" affaire de maison hantée, c'est évident. Une foule de considérations peuvent entrer en ligne de compte qui pourraient être de nature à modifier considérablement les données et donc les conclusions. Voulez-vous quelques exemples ? Ils vont tomber à foison !
Un occidental peut-il avoir une idée précise de ce qu'est la Sibérie ? Nous l'imaginons bien sûr très étendue (mais qu'est-ce que cela représente au juste ?) et très froide, nous avons entendu parler de records, mais est-ce vrai et dans quelle mesure ? Les conditions climatiques, en rapport par exemple avec l'influence de la pression atmosphérique peuvent-ils modifier l'apparence de certains phénomènes et dans l'affirmative dans quelles proportions ? Que savons-nous des Tungus, de leurs coutumes, de leur crédibilité, du paysage tungu, de leurs croyances, de la validité de leurs témoignages ? Mais aussi qui a recueilli ces témoignages et ceux-ci ont-ils fidèlement été transmis ? Y a t'il eu campagne de désinformation ? Dans ce cas de la part de qui et pourquoi ? Tout cela n'est-il vraiment qu'un phénomène naturel très exceptionnel que l'on a voulu faire passer
pour une affaire d'extraterrestres ou au contraire une réelle affaire d'extraterrestres que l'on a préféré taire plutôt que de la divulguer au grand public et que l'on a tenté de mettre sur le compte de la nature, même intersidérale ? Quel fut le réel rôle des Américains et celui des Russes, quelles furent les implications, à ce niveau, dans le contexte de guerre froide ? Est-il possible que les phénomènes décrits proviennent d'une expérience atomique et que les grandes puissances précitées aient bien caché leur jeu à ce sujet ? Que penser de la réplique du phénomène et surtout de la curieuse façon dont les choses ont été traitées en l'occurrence ? Ne s'agit-il pas là encore de désinformation ou d'occultation ? N'a t'on trouvé que des sphérules ou bien également d'autres objets, éventuellement de nature extraterrestre ? A ce sujet, peut-on rapprocher l'affaire de la Toungouska de celle de Roswell ? Doit-on considérer automatiquement que la clé de l'énigme ne sera jamais trouvée parce que les Russes ont été les premiers sur les lieux ? Cette dernière affirmation signifierait-elle que nous ne devons attendre aucune collaboration de la part des Russes en ce qui concerne l'étude des phénomènes paranormaux, surnaturels ou célestes au même titre que les autres pays de l'Est ? L'éclatement de l'ex-URSS, le rapprochement entre les peuples, l'entrée des nombreux satellites de l'ex-URSS dans l'Europe sont-ils susceptibles
de provoquer un revirement spectaculaire des choses et devons-nous donc nous attendre à des révélations extraordinaires dans les prochains temps ? Ne sommes-nous pas aussi victimes des préjugés typiquement occidentaux (mais aussi d'ailleurs) à l'égard de tout ce qui est russe ou en découle directement ou indirectement ? A propos de guerres, puisque le premier événement de la Toungouska date de 1908 et que les deux guerres mondiales se sont déroulées entre temps, celles-ci ont-elles joué un rôle quelconque dans tout cet imbroglio ? Nous pourrions, sur cette lancée, poursuivre encore longtemps l'énumération des questions qu'il y a moyen de se poser. Toutes sont importantes, toutes peuvent jouer un rôle, toutes les réponses peuvent être utiles, à condition bien sûr que ces réponses soient authentiques, correctes, indubitables. Tels des détectives, nous devons impérativement élaborer un plan d'action efficace. Mais il nous faut surtout nous imprégner des sphères objectives et subjectives qui font partie du contexte de l'affaire. Pour ce faire, il nous a fallu recourir à la totalité de nos moyens, tant humains que techniques et intellectuels. A la lecture de ce dossier, le lecteur comprendra mieux que ceux-ci sont finalement loin d'être aussi limités que certains ne le pensent peut-être ! Ainsi, nous nous sommes entourés de collaborateurs parfaitement au courant des
choses de l'Est, à commencer par Mme Svetlana Popova, ressortissante russe vivant actuellement à Plovdiv (Bulgarie), qu'il n'est plus besoin de présenter puisqu'elle occupe le poste de Présidente d'Honneur du CERPI pour la partie Est.
Sa contribution dans l'essor du groupement mais aussi et surtout dans l'avènement de New Belgaria sont éloquents. Elle-même a pu s'appuyer sur la collaboration inconditionnelle de nombreuses connaissances au dessus de tout soupçon. Nous citerons aussi volontiers M. Jean-Paul Godu, surtout célèbre pour sa spécialisation en philatélie (cf.
http://www.philagodu.be) - ( ce qui implique, vu le nombre d'années d'expérience dans le domaine, des connaissances générales très étendues) mais également cofondateur de la défunte SOBEPS. Plusieurs historiens et archivistes, notamment de l'Athénée Royal de Lessines nous ont secondé en ce qui concerne certaines parties de l'enquête. Nous avons également eu recours à certains spécialistes de l'aviation belge figurant dans nos connaissances (dont un ami de
longue date de M.Vanbockestal, Daniel V. qui désire conserver l'anonymat). Bien sûr, notre
praticien et "arme secrète" a été de la partie, il s'est même rendu en Sibérie pour une étude sur place. Faut-il le dire, notre administrateur principal a fait une large partie du boulot en s'entourant lui aussi d'une foule de passionnés du sujet (des anciens de New Belgaria mais également des connaissances obtenues via l'ambassade de Bulgarie, certains anciens du GESO pour une aide sporadique, des anciens de Belgasites pour la partie technique). Il y au aussi toute une myriade de personnes, en principe étrangères au CERPI mais sympathisantes qui se sont penchés sur le sujet et ont
collaboré dans la mesure de leurs moyens. Quelques personnes appartenant la haute société belge (qui ne désirent pas que leur nom figure ici pour des raisons assez évidentes) nous ont aussi prêté main forte.
Sans intérêt la Sibérie ? Cela reste vraiment à voir !
Nous avons déjà parlé de l'intérêt stratégique mais serait bon de signaler aussi que la Sibérie dispose de ressources plutôt
fabuleuses et qu'elle contribue par exemple au quart de la production mondiale de diamant ! Il y a également d'énormes ressources
minières et énergétiques et il n'est donc pas étonnant que le transsibérien ait vu le jour de la peur des Russes de perdre la Sibérie.
Le seul lac Baïkal, dont nous avons parlé plus haut, est un gigantesque réservoir d'eau douce, d'une pureté extrême (proche de la pureté
chimique, visibilité jusqu'à 40m de profondeur !) mais ce n'est pas là sa caractéristique principale, loin s'en faut. Comparable à une mer
(il contient autant d'eau que la mer baltique) très riche dans sa faune propre et avoisinante, il présente aussi la plus grande profondeur
atteinte pour un lac (1637m) et est le plus vieux du monde (25 millions d'années !) Forts de ces considérations, nous pouvons, dans notre
optique, imaginer des implications potentiellement étonnantes à mettre en parallèle avec l'Atlantide. Ne nous aventurons toutefois pas
sur ce terrain, au risque de nous fourvoyer et de réveiller les hypothèses fantaisistes qui ne mèneraient sans doute pas bien loin.
Mais ajoutons tout de même que, pour un lac, il est surprenant d'apprendre que ses eaux sont aussi parfois particulièrement agitées
avec des vagues allant jusqu'à 6m de haut ! Si l'on veut parler de particularités naturelles remarquables, nous sommes donc servis ! Si nous
voulons parler de légendes, il y en a aussi. L'une d'elles nous intéressera tout particulièrement, nous l'évoquerons plus loin.
Mais il y a aussi nombre de villes absolument extraordinaires qui étonnent vraiment le touriste non seulement par leur côté sublime, très
dépaysant (mais ça, on s'en serait doutés) et d'une richesse inouïe sur le plan humain. Par exemple Irkoutsk est une ville superbe.
Avec ses 600.000 habitants, on ne peut pas vraiment la considérer comme un "bled" et elle n'est située qu'à 66 km du lac Baïkal, la perle de
Sibérie. Vous pourriez la rejoindre en avion à partir de Moscou en six heures de vol. Mais nous vous déconseillerions le train
(Transsibérien) surtout si vous êtes pressés car, distances obligent, comptez sur 87 heures de trajet ! Il n'empêche que l'expérience du
Transsibérien mérite d'être vécue elle aussi, nous vous conseillons à ce sujet la visite d'un blog particulièrement éloquent à ce sujet :
http://tiboska.blog.lemonde.fr/voyageensiberie/le-train/ .
Si toutefois vous hésiteriez encore à vous rendre à Irkoutsk pour les vacances, sachez que cette ville est surnommée le "Paris de Sibérie",
notamment en raison de ses trésors architecturaux, là aussi vous trouverez à lire dans le blog en question en allant à la page
Irkoutsk.
De tous temps, nos efforts ont visé à une meilleure connaissance des pays de l'Est, c'est d'ailleurs l'objet de l'un de nos autres sites : New Belgaria
en l'occurrence. Nous considérons en effet que le monde occidental est empreint d'une multitude de préjugés défavorables qu'il faut
absolument s'employer à dénoncer pour rétablir la vérité à laquelle ces pays ont droit. L'éclatement de l'ex-URSS et l'entrée récente de
nombreux anciens satellites de la Russie commencent depuis quelques années à nous donner entièrement raison à ce sujet. Bien sûr, il
est également inutile de vouloir prendre des vessies pour des lanternes et prétendre que tout soit rose et violette dans ces pays encore
méconnus de Monsieur-tout-le-monde, mais nous avons tout à gagner à nous ouvrir à ces pays qui disposent de trésors inimaginables, de beautés à
couper le souffle. Et si New Belgaria a surtout mis l'accent sur la Bulgarie, c'est que celle-ci le méritait amplement, au même titre que de
nombreux pays voisins.
Une légende à considérer par nos soins repose donc, nous l'avons dit, sur le lac Baïkal :
Le grand Baïkal avait trois cent trente-six fils, comme les trois cent trente-six rivières qui s'y jettent, et une seule fille, nommée Angara,
du nom de la seule rivière qui en sort, dont la beauté était sans pareille. Elle aimait le beau Ienissieï, un autre grand fleuve de
Sibérie, qui coule plus à l'ouest, dans lequel se jette l'Angara. Elle s'enfuit donc le rejoindre, alors le vieux Baïkal détacha un rocher de
la montagne et de rage le lança sur la rebelle. Mais rien ne put l'arrêter. Aujourd'hui le rocher dépasse de la surface de l'eau au
milieu de l'embouchure de l'Angara, on l'appelle le Rocher du chaman.
Ce n'est évidemment pas cette légende qui nous empêchera de dormir, elle ne nous donnera pas non plus la clé de l'énigme de la Toungouska.
Mais elle est intéressante dans la mesure où, comme on le sait, toute légende repose sur une part de vérité. Notre conclusion à propos
de cette légende ne peut se formuler que sous la forme d'une question : se pourrait-il qu'un événement naturel de très grande ampleur soit
survenu en Sibérie voilà très longtemps ? Un événement qui par certains côtés rappellerait celui de la région qui nous intéresse.
Reconnaissons que cette hypothèse a peu de poids dans notre étude, mais on peut s'interloquer sur une certaine tendance au bis repetita dans la
région : nous avons vu la possibilité d'un événement majeur au travers de cette légende, nous avons évoqué les possibilités mystérieuses du lac
Baïkal, il y eut l'affaire de la Toungouska et puis sa réplique. La région serait-elle beaucoup plus riche en mystères que nous le pensons ? Devant
un tel déchaînement de violence, à la limite du descriptible, l'hypothèse d'une cause naturelle est séduisante. L'homme
est-il d'ailleurs seulement capable d'un tel pouvoir destructeur ?
Devant
un tel déchaînement de violence, à la limite du descriptible, l'hypothèse d'une cause naturelle est séduisante. L'homme
est-il d'ailleurs seulement capable d'un tel pouvoir destructeur ?
Solution ou complication ?
 Savoir ce que ce n'est pas ne constitue en aucune façon la solution de l'énigme. Il faut savoir ce que c'est ! Nous venons donc d'éliminer une possibilité, mais c'est tout.
Et, apparemment, tout le monde n'est pas d'accord avec nous. Voilà que, à peine commencée, l'affaire rebondit (si l'on ose dire dans ce cas-ci !) et nous ne pouvons pas nous permettre de passer sous silence ce droit de réponse scientifique.
Savoir ce que ce n'est pas ne constitue en aucune façon la solution de l'énigme. Il faut savoir ce que c'est ! Nous venons donc d'éliminer une possibilité, mais c'est tout.
Et, apparemment, tout le monde n'est pas d'accord avec nous. Voilà que, à peine commencée, l'affaire rebondit (si l'on ose dire dans ce cas-ci !) et nous ne pouvons pas nous permettre de passer sous silence ce droit de réponse scientifique.
Estimation récente (2007) de l'événement :
Nous ne sommes pas là pour contester ces chiffres, mais ils parlent d'eux-mêmes : alors que d'une part l'on multiplie le volume par 10 au moins environ, on en diminue la masse de manière très conséquente et tout cela étant supposé provoquer les mêmes effets
sur le terrain. Nous ne contesterons pas cette hypothèse, par respect pour les recherches effectuées et les laboratoires Sandia, mais nous ne pouvons nous empêcher de les considérer comme difficilement défendables. Il faut cependant aussi signaler que si, parallèlement à ces différences notables, on modifie conséquemment la densité du bolide, on peut effectivement rejoindre les idées de Sandia. En effet, selon la vitesse, le lancement d'une balle de ping-pong sur quelqu'un ne lui causera pas grand mal. S'il s'agit d'une plus petite bille de plomb... cela ne sera plus pareil!
L'explication ?
 L'onde de choc fut enregistrée en Europe occidentale et aux États-Unis qui pensèrent immédiatement à une météorite mais l'éloignement de la région et les troubles en Russie ne permirent une étude sur place qu'en 1927 (soit 19 ans plus tard!). Sur les lieux, les scientifiques découvrirent stupéfaits qu'il n'y avait ni cratère, ni trace d'impact, ni débris. Avec l'arrivée de la Guerre froide, seules deux expéditions purent retourner enquêter en 1958 et 1961.
On découvrit une multitude de petites sphères de métal et de silicates dispersées dans le sol de la région qui permit d'émettre
quelques hypothèses jusqu'à ce qu'une étude américaine en 1993 ne découvre qu'il s'agissait d'un petit noyau cométaire, essentiellement composés de gaz gelés qui ont fondu et explosé entre 6 et 9 km d'altitude, le reste de la matière étant dispersé en une pluie de sphérules.
L'onde de choc fut enregistrée en Europe occidentale et aux États-Unis qui pensèrent immédiatement à une météorite mais l'éloignement de la région et les troubles en Russie ne permirent une étude sur place qu'en 1927 (soit 19 ans plus tard!). Sur les lieux, les scientifiques découvrirent stupéfaits qu'il n'y avait ni cratère, ni trace d'impact, ni débris. Avec l'arrivée de la Guerre froide, seules deux expéditions purent retourner enquêter en 1958 et 1961.
On découvrit une multitude de petites sphères de métal et de silicates dispersées dans le sol de la région qui permit d'émettre
quelques hypothèses jusqu'à ce qu'une étude américaine en 1993 ne découvre qu'il s'agissait d'un petit noyau cométaire, essentiellement composés de gaz gelés qui ont fondu et explosé entre 6 et 9 km d'altitude, le reste de la matière étant dispersé en une pluie de sphérules.
Or donc, au moment des événements, l'Europe occidentale et les États-Unis pensent immédiatement à une météorite. Bon ! Ce n'est arrivé que deux fois dans l'histoire de l'humanité mais ils y pensent quand même, soit ! Il est vrai que, a priori, cela peut sembler l'hypothèse la plus vraisemblable. Mais les choses restent en l'état, on n'en saura pas plus avant 1927, soit 19
ans après, lors de la première expédition. Là, les chercheurs s'esclaffent sur l'absence de cratère et de trace d'impact. En effet, les météorites de forte taille sont supposées provoquer des cratères forcément importants lors de leur arrivée au sol. C'est facile à comprendre. Mais les chercheurs, qui sont tout de même aussi supposés ne pas être les derniers des cancres et être dotés d'un certain sens de l'observation, à même de tirer des conclusions logiques et effectuer un travail poussé, ne découvrent aucun débris
OK.
Et c'est là que les choses ne vont vraiment plus puisqu'en 1958 et 1961, deux expéditions retournent sur les lieux, cette fois avec 50 et 53 ans de retard (voilà qui va solidement modifier l'opinion publique à propos des transports en commun...) Là, les scientifiques découvrent une multitude de sphérules métalliques !
 Cela ne vous fait pas bondir, vous ? 19 ans après les faits, on ne découvre aucun débris, mais 31 ans encore plus tard , on en trouve une multitude !
Cela ne vous fait pas bondir, vous ? 19 ans après les faits, on ne découvre aucun débris, mais 31 ans encore plus tard , on en trouve une multitude !
Allons bon ! Lancez donc une bille métallique en l'air et voyez s'il lui faudra cinquante ans pour retomber !
Or donc, ou bien les premiers chercheurs étaient vraiment des cancres, borgnes et aveugles (ou encore ne cherchaient-ils pas au
bon endroit ? Mais puisqu'il y en avait soi-disant une multitude...) ou bien nous sommes en présence d'un sous phénomène avec l'apparition subite des sphérules en question.
Définir un plan d'action...
Cette fameuse Sibérie !
 Chez nous, en Europe et en pas mal d'autres endroits du monde, on évoque parfois la Sibérie dans les conversations de salon pour désigner une vaste région russe aux conditions climatiques particulièrement rigoureuses (à cause du froid), vaste et sans grand intérêt (plaines désertiques, paysages monotones à perte de vue, etc.) On fait subrepticement allusion à la deuxième guerre mondiale et aux soldats allemands qui étaient envoyés sur le front russe en guise de punition et bien peu en revenaient. On parle aussi des troupes napoléoniennes qui se cassèrent les dents sur le géant russe. Et on y va d'une blague à bon marché (quoi que...) pour dire qu'il vaut mieux ne pas uriner à l'extérieur en Sibérie sous peine de gros problèmes que l'on imagine facilement en rapport avec les records de températures négatives. Rien d'engageant donc à visiter la Sibérie et ce
n'est pas là que l'on penserait passer ses vacances... Voilà grosso modo pour les préjugés et les clichés traditionnels qui ne sont d'ailleurs pas tous entachés d'erreur.
Chez nous, en Europe et en pas mal d'autres endroits du monde, on évoque parfois la Sibérie dans les conversations de salon pour désigner une vaste région russe aux conditions climatiques particulièrement rigoureuses (à cause du froid), vaste et sans grand intérêt (plaines désertiques, paysages monotones à perte de vue, etc.) On fait subrepticement allusion à la deuxième guerre mondiale et aux soldats allemands qui étaient envoyés sur le front russe en guise de punition et bien peu en revenaient. On parle aussi des troupes napoléoniennes qui se cassèrent les dents sur le géant russe. Et on y va d'une blague à bon marché (quoi que...) pour dire qu'il vaut mieux ne pas uriner à l'extérieur en Sibérie sous peine de gros problèmes que l'on imagine facilement en rapport avec les records de températures négatives. Rien d'engageant donc à visiter la Sibérie et ce
n'est pas là que l'on penserait passer ses vacances... Voilà grosso modo pour les préjugés et les clichés traditionnels qui ne sont d'ailleurs pas tous entachés d'erreur.
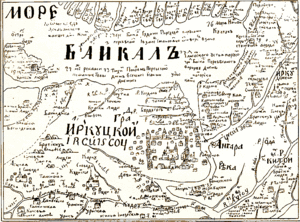 Vaste, la Sibérie l'est assurément.
Vaste, la Sibérie l'est assurément.
Pour les Français, les habitants du plus grand pays d'Europe, les choses sont un peu différentes, mais un peu seulement. Ils ne vivent pas à la même échelle que nous. S'ils doivent rendre visite à une connaissance qui n'habite qu'à 250 km, c'est raisonnable. Pour un belge, la traversée de la France représente une expérience éprouvante, qui lui semble interminable. J'en sais quelque chose pour l'avoir fait en 2000 afin de me rendre en Espagne, sauf que, en plus de la route, il faut encaisser le comportement des automobilistes irresponsables bleu blanc rouge, lesquels doivent trouver leurs permis
de conduire parmi les cadeaux Bonux. Et pourtant, cela se fait avec une infrastructure routière très convenable en dépit du manque d'éclairage nocturne. Un français se trouvera sans doute un peu dans la peau d'un belge s'il doit traverser les États-unis... Les distances lui paraîtront démesurées, incroyables là où l'américain trouvera cela tout à fait normal.
Et, soyons clairs, la Sibérie est encore nettement plus grande que les États-unis !
 Citons quelques chiffres pour essayer de situer un peu les choses : La Sibérie (Сибирь, du russe Sibir) est une immense
région d'une surface de 13,1 millions de km²(environ 24 fois la surface de la France)
très peu peuplée (39 millions d'habitants soit environ 3 habitants au km²). Située à l'est de la Russie elle s'étend de l'Oural jusqu'à
l'océan Pacifique vers l'ouest et de l'océan Arctique au nord jusqu'aux monts Altaï au nord du Kazakhstan et aux frontières mongoles et
chinoises. La Sibérie constitue la partie asiatique de la Russie et la partie nord de l'Asie. Cette région, qui représente 77% de la surface de
la Russie mais seulement 27% de sa population, est caractérisée par un climat froid et extrêmement continental, et un paysage au relief modéré
sillonné par d'énormes fleuves. Longtemps habitée par des populations pastorales, elle a été progressivement colonisée par l'Empire russe. La
Sibérie a connu un formidable développement au cours du
XXesiècle
grâce à une politique d'investissement volontariste du régime soviétique cherchant à mettre en valeur les immenses ressources minières et
énergétiques de cette région. Sibérie tient son nom de la petite ville de Sibir. L'étymologie du mot est incertaine mais le terme pourrait
provenir du turco-mongol sibir désignant un peuplement très dispersé. (Wikipédia).
Citons quelques chiffres pour essayer de situer un peu les choses : La Sibérie (Сибирь, du russe Sibir) est une immense
région d'une surface de 13,1 millions de km²(environ 24 fois la surface de la France)
très peu peuplée (39 millions d'habitants soit environ 3 habitants au km²). Située à l'est de la Russie elle s'étend de l'Oural jusqu'à
l'océan Pacifique vers l'ouest et de l'océan Arctique au nord jusqu'aux monts Altaï au nord du Kazakhstan et aux frontières mongoles et
chinoises. La Sibérie constitue la partie asiatique de la Russie et la partie nord de l'Asie. Cette région, qui représente 77% de la surface de
la Russie mais seulement 27% de sa population, est caractérisée par un climat froid et extrêmement continental, et un paysage au relief modéré
sillonné par d'énormes fleuves. Longtemps habitée par des populations pastorales, elle a été progressivement colonisée par l'Empire russe. La
Sibérie a connu un formidable développement au cours du
XXesiècle
grâce à une politique d'investissement volontariste du régime soviétique cherchant à mettre en valeur les immenses ressources minières et
énergétiques de cette région. Sibérie tient son nom de la petite ville de Sibir. L'étymologie du mot est incertaine mais le terme pourrait
provenir du turco-mongol sibir désignant un peuplement très dispersé. (Wikipédia).
Treize millions de kilomètres carrés ! Cela vous dit quelque chose ? La Chine, avec ses 9.596.960km2
n'arrive qu'en troisième position derrière la Russie (qui contient la Sibérie) et le Canada. Si vous désirez
traverser la Sibérie dans toute sa longueur, il vous faudra prendre le
Transsibérien, ce fameux train mythique qui constitue aussi la plus
longue voie ferrée du monde avec plus de 9000 km. Il vous faudra 14 jours pour rallier ainsi Moscou à Irkoutsk et un mois pour rejoindre
Vladivostok !
Cette étendue inimaginable et le fait de savoir que le transsibérien n'a été construit que de 1891 à 1916 (les trains ont commencé à circuler, de
manière partielle, en 1900 et le trafic régulier en 1916) nous permettent de conclure que ce territoire représente géographiquement un
très considérable potentiel stratégique, mais aussi que, en 1908 (date des événements de la Toungouska), les liaisons étaient encore loin
d'être optimales. Un voyage en Sibérie, principalement à cette époque, représentait à lui seul une expédition tout particulièrement
hasardeuse, nombre de périls attendaient les voyageurs (animaux sauvages, brigands, conditions de vie souvent épouvantables),
inconcevable et même suicidaire que de vouloir s'y rendre à pied, réseau routier (comme nous le concevons) inexistant ou extrêmement
rudimentaire, navigation fluviale débutante et problématique, pas toujours praticable dans les deux sens. Bref, il est d'une part
compréhensible que la première expédition scientifique n'ait eu lieu qu'en 1927, alors que les choses s'étaient quelque peu décantées (il ne
faut pas oublier que, entre temps, il y eut non seulement la guerre 1914-18, la révolution russe 1917 et la guerre russo-hongroise en 1920
et la guerre civile de 1918-21...) et qu'il y a peu de chances pour que des études vraiment sérieuses aient été réalisées plus récemment après
l'explosion. Malheureusement, cette hypothèse ne peut pas non plus être complètement écartée vu l'immense potentiel russe et l'occultation
qu'elle faisait volontiers de ses agissements. Ce qui est certain en revanche, c'est que la Russie n'accepta l'intervention d'expéditions
étrangères qu'à partir de 1953, soit 45 ans après les faits.
 Un autre point est encore à prendre en considération à
propos de la Sibérie et ce ne sera probablement pas celui qui la décrira de la manière la plus favorable. C'est que, longtemps, la Sibérie
fut une espèce de réservoir de déportés, prisonniers, favoris de la cour tombés en disgrâce, criminels de droit commun, etc. Si on ajoute
ce point au fait que la région est très peu peuplée (3 habitants au km2), qu'au moment des faits qui nous intéressent la cartographie était
sinon inexistante du moins très rudimentaire (on ignore par exemple si le lac Chiko existait déjà avant 1908) et que les ressources locales
étaient encore peu connues, on comprend entre les lignes que l'endroit était assez bien indiqué pour d'éventuelles expérimentations d'armes de
destruction massive, comme le désert du Nevada l'a été pour les expériences nucléaires américaines.
Un autre point est encore à prendre en considération à
propos de la Sibérie et ce ne sera probablement pas celui qui la décrira de la manière la plus favorable. C'est que, longtemps, la Sibérie
fut une espèce de réservoir de déportés, prisonniers, favoris de la cour tombés en disgrâce, criminels de droit commun, etc. Si on ajoute
ce point au fait que la région est très peu peuplée (3 habitants au km2), qu'au moment des faits qui nous intéressent la cartographie était
sinon inexistante du moins très rudimentaire (on ignore par exemple si le lac Chiko existait déjà avant 1908) et que les ressources locales
étaient encore peu connues, on comprend entre les lignes que l'endroit était assez bien indiqué pour d'éventuelles expérimentations d'armes de
destruction massive, comme le désert du Nevada l'a été pour les expériences nucléaires américaines. Passer
ses vacances en Sibérie ? C'est vrai que cela semble une drôle d'idée ! Ce genre de périple à l'autre bout du monde ou
presque, qui conduirait dans un continent apparemment hostile et désert, qui nécessiterait 24 mois au moins pour en avoir une vue d'ensemble
partielle, très peu pour la plupart des occidentaux et... il s'agit d'une erreur profonde. Quelques personnes courageuses ont franchi
le pas... pour leur plus grand bonheur et tous ont rapporté, à l'unanimité que la Sibérie est un "pays" d'une toute grande beauté.
Bien sûr, on y trouve d'immenses régions où seule la nature s'impose en maître(sse) mais celle-ci vaut déjà nettement son pesant d'or.
Passer
ses vacances en Sibérie ? C'est vrai que cela semble une drôle d'idée ! Ce genre de périple à l'autre bout du monde ou
presque, qui conduirait dans un continent apparemment hostile et désert, qui nécessiterait 24 mois au moins pour en avoir une vue d'ensemble
partielle, très peu pour la plupart des occidentaux et... il s'agit d'une erreur profonde. Quelques personnes courageuses ont franchi
le pas... pour leur plus grand bonheur et tous ont rapporté, à l'unanimité que la Sibérie est un "pays" d'une toute grande beauté.
Bien sûr, on y trouve d'immenses régions où seule la nature s'impose en maître(sse) mais celle-ci vaut déjà nettement son pesant d'or.